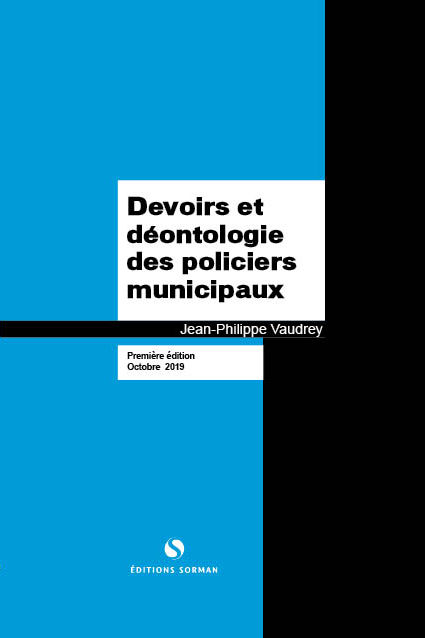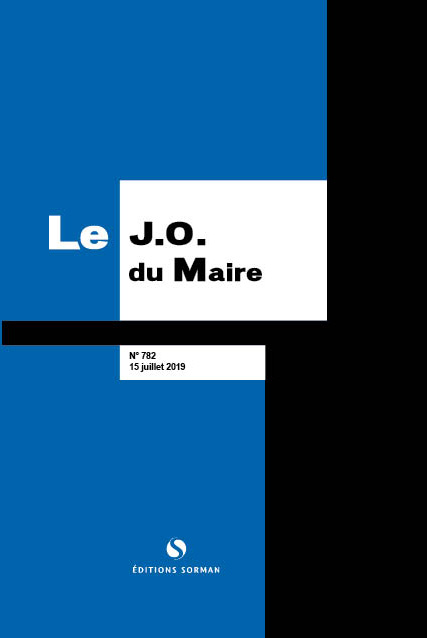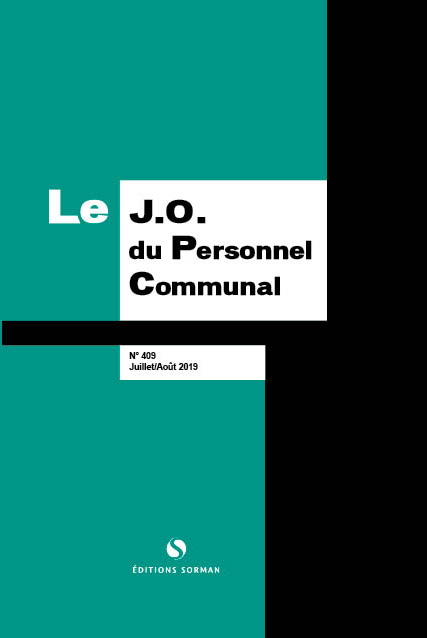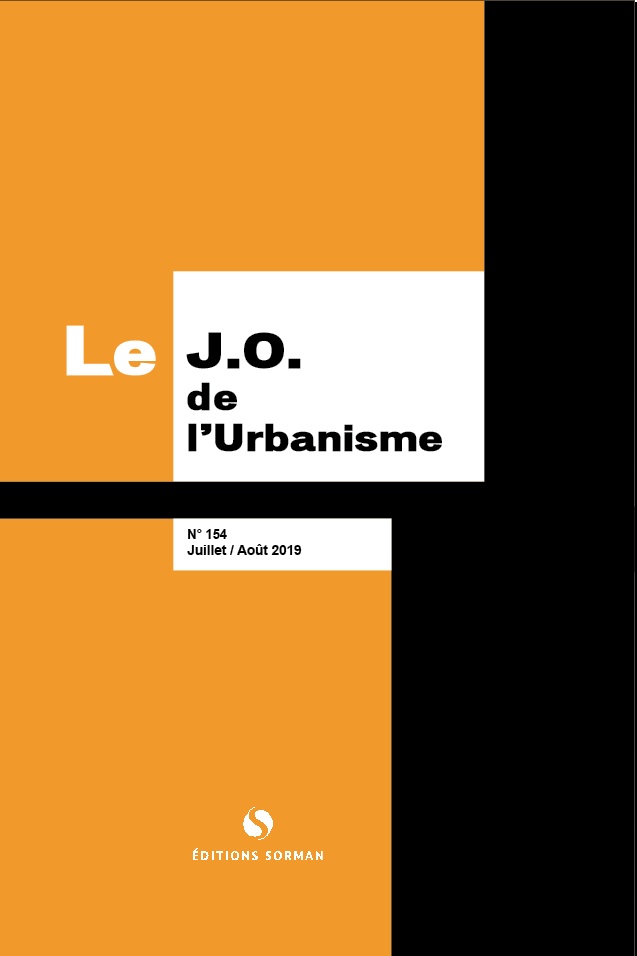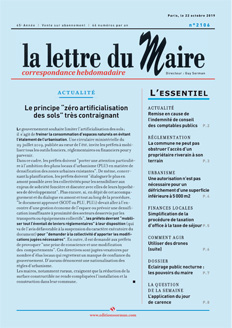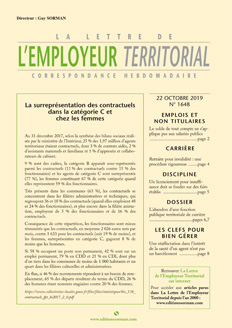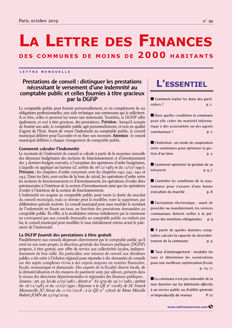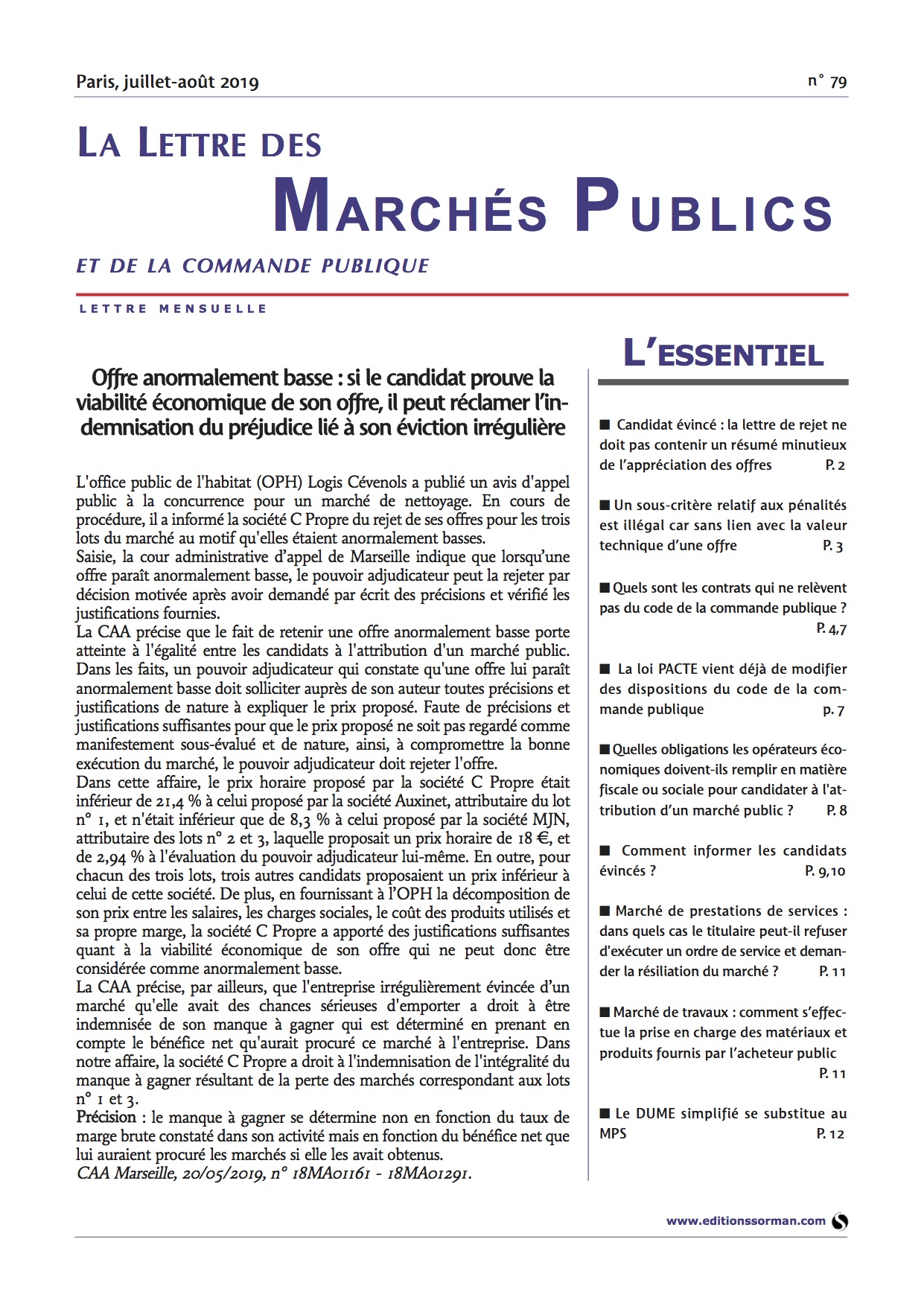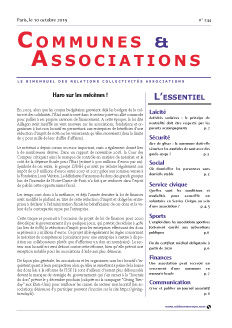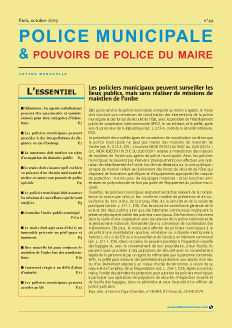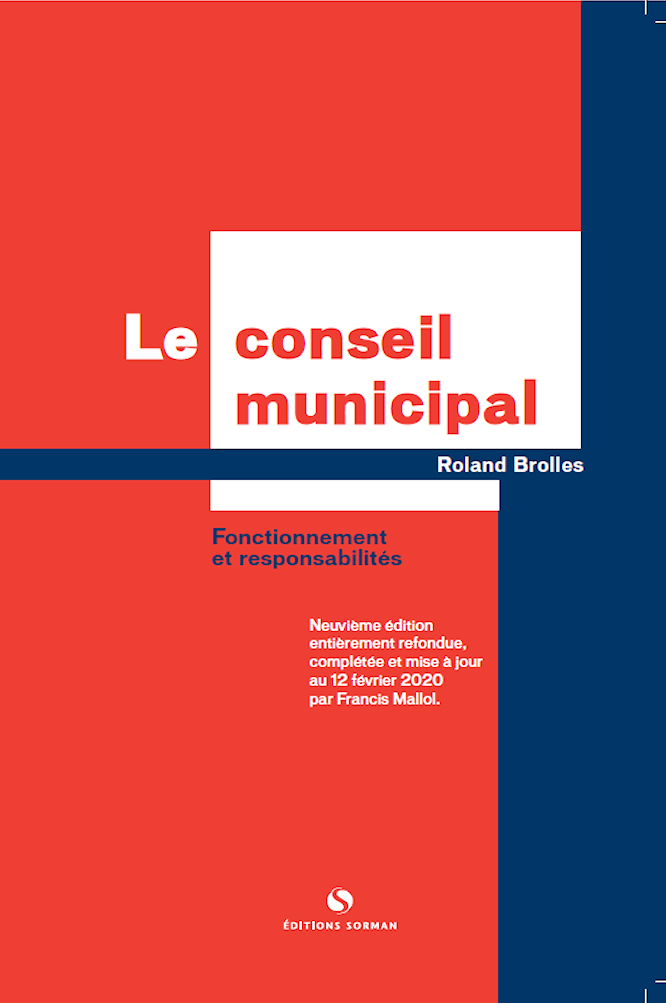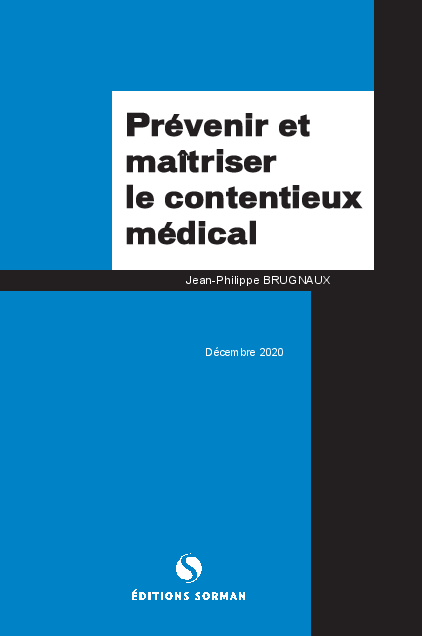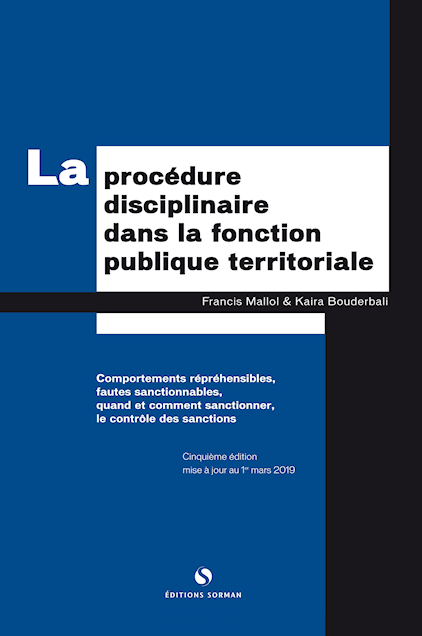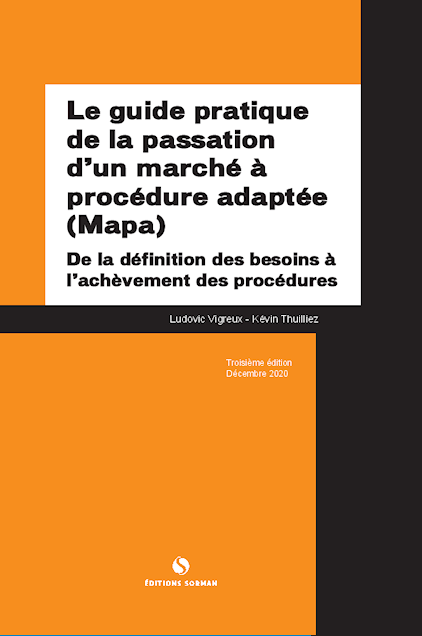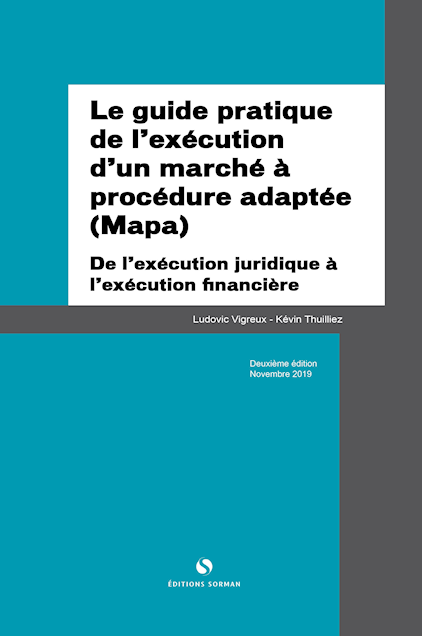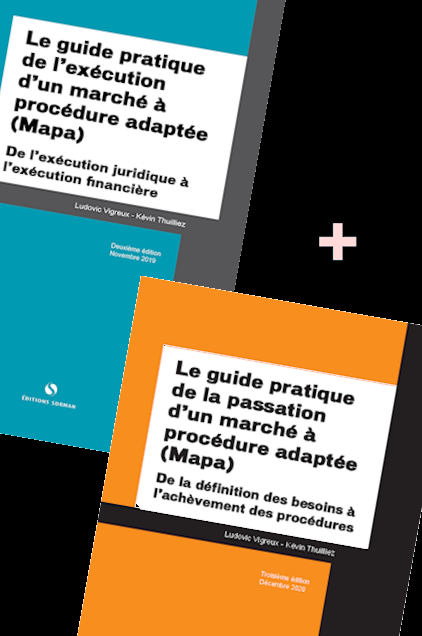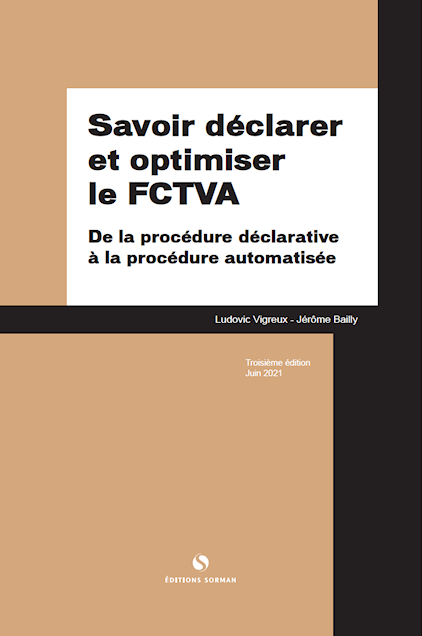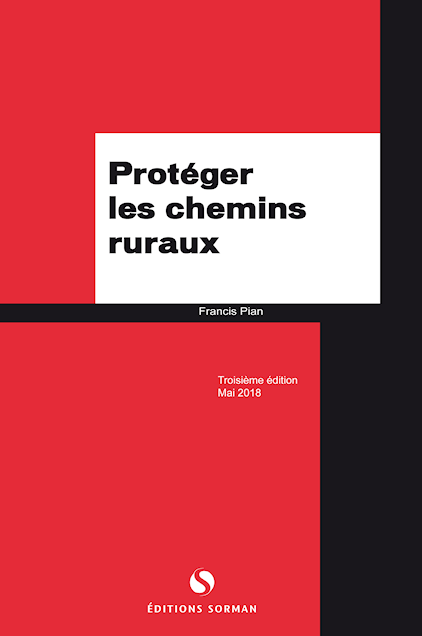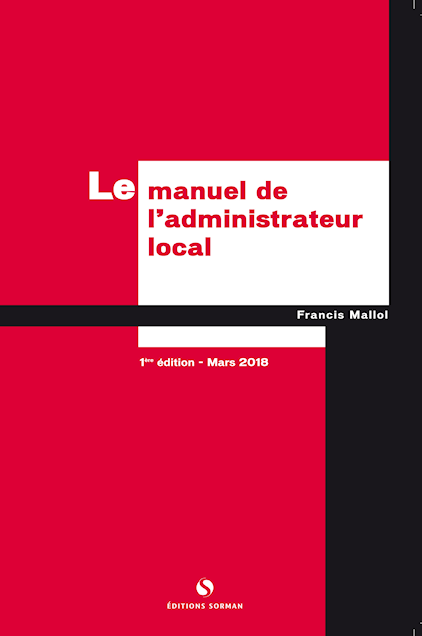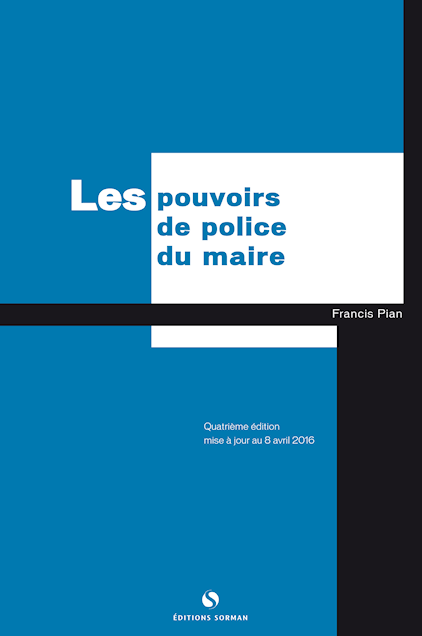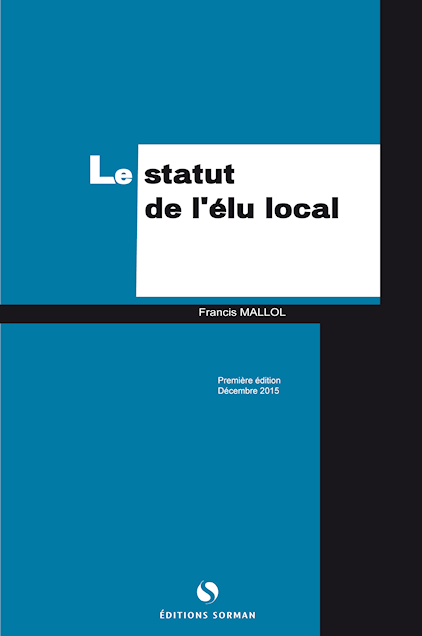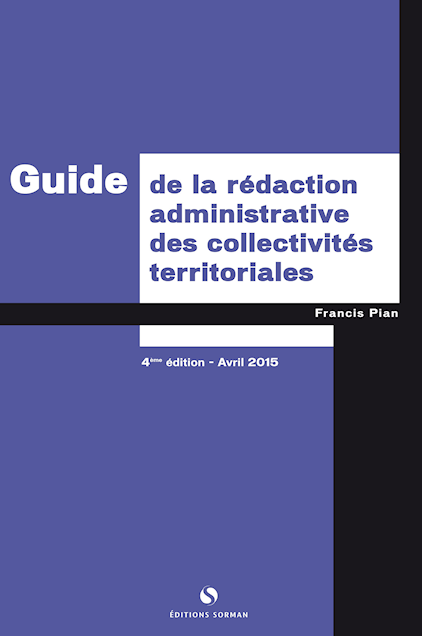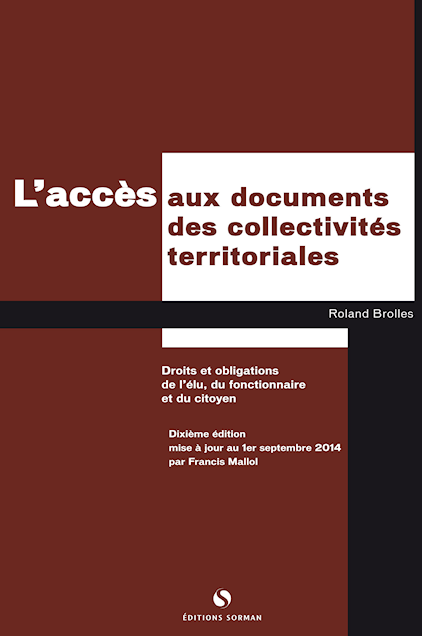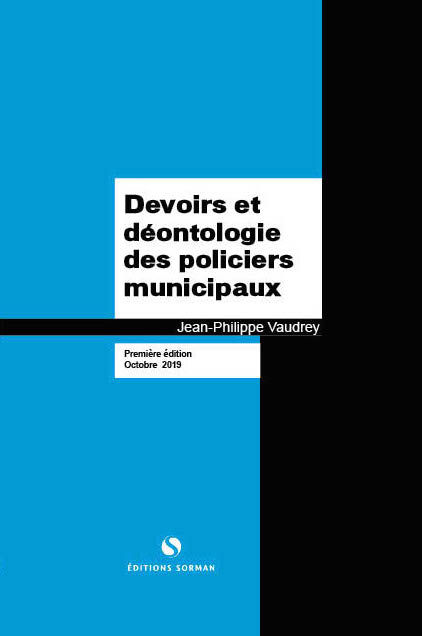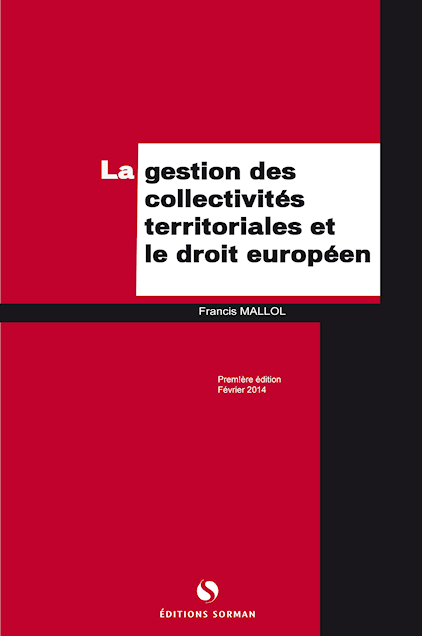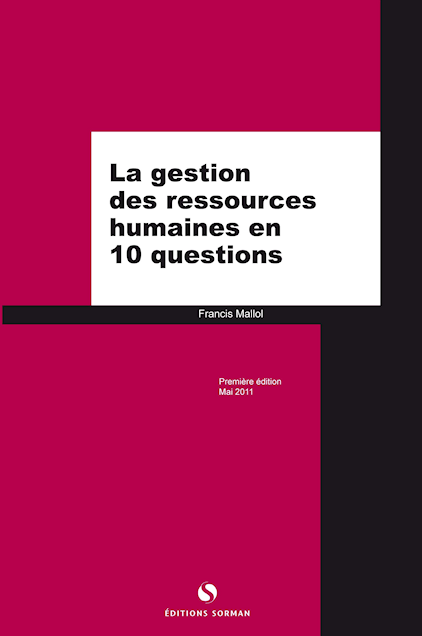Dans quelles conditions attribuer ou refuser une subvention aux associations ? Abonnés
Rappelons, en premier chef, qu'aucune association ne peut revendiquer un droit à une subvention ou à son renouvellement. La décision du conseil municipal est souveraine et n'a même pas à être motivée. Toutefois, par précaution, le maire devra inviter ses colistiers à éviter les écrits ou commentaires qui risqueraient d’être interprétés comme une forme quelconque de ségrégation sociale, politique, raciale ou confessionnelle.
Quel risque court une commune qui ne s'entourerait pas des précautions indispensables préalablement à l'attribution d'une subvention ?
Les risques sont multiples et de nature diversifiée. Il s'agit de risques politiques, de risques financiers et de risques de mise en cause de la responsabilité de la commune.
Les risques politiques
Attribuer ou refuser une subvention est une décision éminemment politique. Allouer une subvention c'est donner délégation à un tiers pour gérer des fonds publics et user de la contribution fiscale des ménages ou autres acteurs économiques locaux. Si elle est refusée alors même que l'association joue un rôle structurant dans l'animation de la cité et mobilise de nombreux bénévoles, offre des services dans des conditions particulièrement avantageuses à la population (à faible revenus notamment) la décision paraîtra inappropriée à une majorité d'électeurs. Si elle est accordée alors même que le rôle sociétal de l'association est peu perceptible (association fermée, par exemple, bénéficiant à un nombre restreint de personnes partageant un intérêt commun), elle sera forcement contestée. Mais le fondement de la décision est plus délicat. En effet certaines associations sont de véritables institutions locales sans pour autant que leur "efficacité" soit démontrée. Des situations sont encore plus complexes, telles les subventions accordées à "Paris Foot Gay" ou à un club de football composé uniquement de ressortissants de certains pays. Enfin, le risque est réel en cas de subventions affectées à un projet spécifique qui ne serait visiblement pas viable ou qui ne se réalise jamais.
Les risques juridiques
Le risque le plus sensible réside dans le "soutien abusif à une association". Cette théorie est la simple transposition de ce qui s'applique aux sociétés commerciales. Dans cette hypothèse, la collectivité peut être appelé solidairement ou partiellement en comblement de passif (art. L. 651-1, code de commerce)
Cette procédure permet au tribunal de grande instance de mettre à la charge des dirigeants tout ou partie de l’insuffisance d’actifs pour apurer les dettes de l’association liquidée, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actifs. Cette procédure est applicable à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait (personnes physiques ou morales, y compris les personnes morales de droit public, dont la commune).
La responsabilité de la commune dans le cadre d'une association transparente
Le juge administratif a également estimé que la responsabilité de la commune peut être engagée en raison d'actes de gestion de l’association lorsque celle-ci est « transparente », au sens de la jurisprudence financière ; en d'autres termes, lorsque l’association a été créée à l’initiative d’une collectivité qui en contrôle l’organisation et le fonctionnement, qu’elle agit dans le cadre des compétences de la collectivité en dehors des règles de la commande publique (marchés et DSP) et lorsque ses ressources proviennent de la commune. Le risque est accru si un agent de la collectivité est détaché (ou mis à disposition) auprès de l'association pour la diriger et si un nombre de fautes de gestion peut être relevé, révélant des dysfonctionnements dans la comptabilité de l’association dont la commune aurait dû avoir connaissance. Rappelons que les associations transparentes accroissent les risques de mise en cause pour prise illégale d'intérêt et délit de favoritisme.
Les risques financiers
La juridiction dispose de toute latitude pour établir un partage de l’insuffisance d’actif entre les différentes personnes responsables des fautes de gestion relevées et peut les déclarer solidairement responsables. Le juge administratif a considéré que le comportement fautif d’une collectivité dans son obligation de contrôle peut être de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis des créanciers d’une structure liquidée. Le régime de la responsabilité pour faute lourde a été appliqué à l'occasion de diverses carences dans le contrôle exercé par l’État sur l’utilisation de subventions données à des associations. L’État a été condamné pour avoir effectué un contrôle « lacunaire, tardif et inopérant » d’une association tout en continuant à verser des subventions substantielles, et alors qu’il était représenté dans ces instances sans exercer son pouvoir d’investigation et de sanction. La responsabilité de l’État a été engagée alors que la gestion de l’association était entachée d’irrégularités comptables et réglementaires extrêmement graves qui avaient été publiquement mises en exergue par un rapport de la Cour des comptes.
Cette position du juge administratif à l'encontre de l'État est tout à fait transposable à une commune qui n'aurait pas effectué les contrôles de la situation financière de l'association et qui de ce fait commettrait une faute de gestion condamnable. Ce risque est accru lorsque la commune, même indirectement, exerce une influence sur les décisions de l'association. Tel fut le cas de la commune de Merlebach (Moselle) qui avait assigné au club de football ? des objectifs (dont dépendait la subvention) trop ambitieux, à l'origine du dépôt de bilan.
Le rôle des Chambres régionales des comptes
Les Chambres régionales des comptes exercent leur pouvoir de contrôle en application de l’article 87 de la loi du 2/3/1982. À ce titre, elles peuvent assurer la vérification des comptes et de la gestion des organismes sans but lucratif bénéficiant de concours financiers des collectivités territoriales mais aussi d’organismes dépendant de ces collectivités. Le président de la chambre régionale prend une décision officielle de vérification. Cette décision est notifiée au président de l’association et doit
préciser les exercices sur lesquels portera la vérification.
La décision est notifiée à la commune et aux présidents des organismes qui y sont rattachés et qui allouent des aides financières ou en nature (personnel, locaux moyens matériels...) ainsi qu’au préfet. Les pouvoirs d’investigation des magistrats de la Cour des comptes et des Chambres régionales des comptes sont très larges.
Les responsables des associations contrôlées sont tenus de leur fournir tous renseignements relatifs à la gestion de l’organisme.
La loi n° 95-127 du 8/2/1995 permet, par ailleurs, aux magistrats de demander aux cocontractants des associations les factures et registres se rapportant aux opérations passées avec elles (attention aux reversements indus de rémunérations ou autres versements de complaisance).
Précision : la loi n° 91-772 du 7 août 1991 a étendu ce contrôle aux organismes qui font appel à la générosité publique, ce qui est le cas de beaucoup d'associations et fondations reconnues d'utilité.
La gestion de fait
La procédure de gestion de fait consiste à réintégrer dans la comptabilité du comptable public des fonds et valeurs qui n’y étaient pas entrés ou qui en étaient sortis irrégulièrement. Tel est le cas lorsque les subventions ont financé des activités qui auraient dû relever de la compétence directe de la collectivités ou lorsque l'association est transparente. Outre la gestion de fait, la Cour saisie par une Chambre régionales des comptes peut déférer devant la cour de discipline budgétaire les responsables ou gestionnaires d’associations subventionnées et les élus qui sont intervenus, sans y être habilités, dans la gestion d’organismes relevant de la compétence de la commune.
Le contrôle des associations par les communes se fonde initialement sur les décrets-lois du 30/10/1935 et du 2/5/1938. Ainsi, les organismes sans but lucratif étaient-ils déjà tenus de “fournir, à l’autorité qui a mandaté la subvention, une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité”, pour les collectivités et, leurs “budgets et comptes à l'autorité publique qui accorde la subvention”, pour l’État. Les autres fondements légaux du contrôle des associations sont à rechercher dans l’article 31 de l’ordonnance du 23/9/1958 relative à la vérification de l’utilisation des subventions et l’article 43 de la loi du 12/4/1996 portant Diverses Dispositions d’Ordre Économique et Financier (D.D.O.E.F.). Ce dernier texte traduit la volonté du Parlement de contrôler les deniers publics et l’usage qui en est fait. Le dispositif mis en place permet en effet à l’Inspection Générale des Finances, aux comptables supérieurs du trésor et à l’inspection générale de l’administration de contrôler de plein droit, sur pièces et sur place.
Enfin, aux termes de l’article L. 111-7 du code des juridictions financières, “la Cour des comptes peut exercer dans des conditions fixées par voie réglementaire un contrôle sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l’État, d’une autre personne morale soumise à son contrôle ainsi que de la Communauté Européenne”.
Jacques KIMPE le 15 mai 2014 - n°126 de Communes et Associations
- Conserver mes publications au format pdf help_outline
- Recevoir par mail deux articles avant le bouclage de la publication.help_outline
- Créer mes archives et gérer mon fonds documentairehelp_outline
- Bénéficier du service de renseignements juridiqueshelp_outline
- Bénéficier du service InegralTexthelp_outline
- Gérer mon compte abonnéhelp_outline